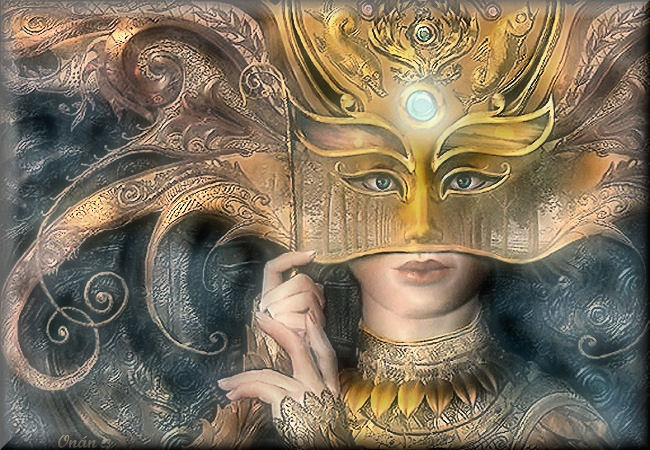par Pierre Noël
Le Rite Ecossais Rectifié occupe une place singulière dans la Maçonnerie contemporaine. Pratiqué en Suisse, en France et en Belgique, il est trop souvent l’objet de polémiques passionnées, certains y voyant la forme la plus pure de l’initiation maçonnique, d’autres un rejeton abâtardi, voire dévoyé, de la maçonnerie classique. La pierre de touche de ce débat est le christianisme, vrai ou supposé, qui imprégnerait ce Rite d'”ancien régime”, parfois qualifié par ses détracteurs de “crypto-catholique”. Certes, l’atmosphère y est plus religieuse, sinon plus mystique, mais est-ce suffisant pour justifier l’anathème et la marginalisation? Trop souvent d’ailleurs de telles attitudes sont le fait de maçons, par ailleurs sincères, qui n’ont du Rectifié qu’une connaissance lointaine, basée plus sur des racontars que sur une expérience personnelle. Le fait est regrettable, d’autant que le Rectifié présente l’avantage inestimable d’être aisément accessible à l’analyse, les intentions de ses fondateurs nous étant connues par les innombrables documents et exégèses qu’ils ont laissés. Le caractère parfois archaïque de ses rituels peut surprendre, certes.
Encore faut-il comprendre que la survivance de formes d’apparence obsolète résulte d’abord de l’extinction quasi-complète du Rite au XIX° siècle et de sa renaissance inattendue en notre siècle. La première lui permit d’échapper aux réformes dont furent l’objet les autres Rites, Français ou Ecossais, réformes conditionnées par les luttes politiques et religieuses du temps, lesquelles donnèrent à la franc-maçonnerie un visage que n’auraient reconnu ni les pasteurs britanniques des origines ni les maçons lyonnais de 1778. La seconde nous le restitua (presque) inchangé, tel qu’il fut imaginé au confluent du Rhône et de la Saône entre 1778 et 1809. Si le Rite Rectifié paraît aujourd’hui incongru, voire scandaleux, n’est-ce pas justement à cause de cette fidélité à une certaine image de la maçonnerie dont nos contemporains ont peine à prendre conscience? Le travail qui suit n’a d’autre ambition qu’une présentation succincte de la chronologie et de l’évolution des rituels “symboliques” de ce Rite trop souvent décrié.
Il ne s’agit pas d’une exégèse, moins encore d’un exposé systématique de sa doctrine, tâche d’une autre envergure à laquelle je me risquai autrefois (G.Verval, 1987), mais plutôt du simple débroussaillage d’un paysage passablement confus où se mêlent faits et légendes que chacun utilise à sa guise.
Tel qu’il fut conçu, le Rite Ecossais Rectifié devait comporter trois étapes successives, concentriques dirait J.F.Var, composées des grades “symboliques”, de l’Ordre Intérieur chevaleresque et de la (Grande) Profession. Seules sont effectives de nos jours les deux premières. La troisième relève, faute de mieux, de l’érudition personnelle grâce à la publication des textes fondateurs du “Saint Ordre”, comme ses thuriféraires aiment à appeler, à tort, la Profession. Je ne m’occuperai ici que des grades symboliques.
Ceux-ci sont au nombre de quatre : à l’apprenti, au compagnon et au maître fait suite le “maître écossais de Saint André”. Au XVIII° siècle, ces quatre grades étaient régis par un directoire écossais dont les pouvoirs furent définis à Lyon en 1778. N’y voyons là rien qui surprenne. A la même époque la Grande Loge anglaise, dite des “Anciens”, exerçait son autorité sur quatre degrés, le dernier étant le “Royal Arch”. Il n’en va plus de même aujourd’hui. Les trois premiers grades rectifiés relèvent exclusivement de l’autorité des Grandes Loges tandis que le “maître écossais” est conféré dans des “loges de Saint-André” dépendant des Directoires écossais, terme qui “au symbolique” désigne les Grands Prieurés de l’Ordre bienfaisant des Chevaliers maçons de la Cité Sainte. Cette dichotomie est condition de “régularité” au sens qu’a pris ce mot durant les premières décennies de ce siècle. Nul ne désire la remettre en cause.
I. Jean-Baptiste Willermoz et la maçonnerie lyonnaise.
1. Introduction de la Stricte Observance à Lyon.
Ce lyonnais d’une exceptionnelle longévité (1730-1824), fabricant d’étoffes et commissionnaire en soieries, fut à l’évidence le père du Rectifié. Initié en 1750 dans une loge oubliée, il en devint vénérable en 1752 (A.Joly, 1938, p.5). Fondateur en 1756 de la “Parfaite Amitié”, constituée par la Grande Loge de France, il en tint le premier maillet jusqu’en 1762. Il contribua entre temps à la fondation de la Grande Loge des Maîtres Réguliers de Lyon (1760), plus tard Mère-Loge de Lyon. Il fallait, écrivit-il plus tard, “être chevalier d’Orient pour y être admis” (in Steel-Maret, 1893, pp.147-153). Cette Grande Loge ne se voulait-elle pas chargée “à l’instar de celle de Paris…de veiller au maintien de la discipline des loges, de fixer le choix de l’uniformité des grades symboliques jusques et y compris le chevalier d’Orient”? Elle pratiquait officiellement sept grades, soit après les trois premiers ceux de maître élu, maître parfait, maître écossais et chevalier d’Orient. Là ne s’arrêtaient pas les connaissances de Willermoz qui, à l’époque, n’avait de cesse de collectionner grades, décors et rituels. Dans une lettre qu’il adressa le 2 mars 1763 à Chaillon de Jonville, substitut général du Grand Maître de la Grande Loge de France, il fit suivre sa signature des titres suivants : Maître écossais, G(rand) A(rchitecte), R(oï)al Arch, Chevalier d’Orient, d’Occident, du Soleil, de l’Aigle noir, R(ose) C(roix), G.I.G.E.ch.K. (c’est à dire Grand Inspecteur, Grand Elu, chevalier Kadosh) (reproduit en fac_similé dans Renaissance Traditionnelle, 1992, 89:31) [1]. Les grades supérieurs au chevalier d’Orient étaient pratiqués dans un chapitre des chevaliers de l’Aigle noir, fondé en 1763 ou 1765 et présidé par le propre frère de Willermoz, Pierre-Jacques, médecin, alchimiste, esprit curieux de tout et très en avance sur son temps (A.Joly, 1938, p.15). Ce chapitre très fermé vit peut-être la création du grade de Rose-Croix dont le succès ne devait jamais se démentir.
Au début de leur carrière, Willermoz et ses proches pratiquèrent donc cette maçonnerie qui sera appelée plus tard de “Rite Français”. Jamais cependant elle ne put les satisfaire entièrement. Willermoz était trop intimement convaincu que la maçonnerie devait receler des connaissances “sublimes” pour se satisfaire d’un système aussi rudimentaire que décevant à ses yeux. Il chercha hors des loges classiques ces “vérités essentielles” qu’il devinait sous le couvert des allégories maçonniques héritées des spéculatifs britanniques. Il crut les trouver, en 1767, dans l’Ordre des “chevaliers Elus Coens de l’Univers” du théosophe Martinez de Pasqually. Reçu en 1768 au grade ultime de Réau-Croix, il avait créé à Lyon un “Tribunal” d’Elus Coens, réservé à ses intimes, et s’était consacré avec ferveur, quoique sans succès bien assuré, aux expériences théurgiques prescrites par le “Grand Souverain” de l’Ordre, Don Martinez. Déçu peut-être par les “Esprits Intermédiaires” qui se refusaient à lui, désemparé par le départ de son maître qui, en 1772, quitta la France pour n’y plus revenir [2], Willermoz écouta d’autres sirènes sans pour autant oublier l’enseignement du disparu ( de 1774 à 1776, les élus coens lyonnais continuèrent à se réunir assidûment, ce dont témoignent leurs “conférences” éditées par A.Faivre en 1975 aux éditions du Baucens, Braine-le-Comte).
En 1772, des correspondants strasbourgeois l’informèrent de l’existence outre-Rhin d’une forme nouvelle de maçonnerie, caractérisée par sa belle ordonnance et le sérieux de ses “connaissances”, la Stricte Observance, ou plus exactement “l’Ordre supérieur des chevaliers du temple sacré de Jérusalem”. Fondée en 1751 par le baron (FreiHerr) Charles-Gotthelf von Hund (1722-1776), elle enseignait que la francmaçonnerie n’était autre que la perpétuation de l’Ordre du Temple, aboli en 1312 par le pape Clément V sur ordre du roi de France, Philippe IV “le Bel”. Dirigée par de mystérieux “Supérieurs Inconnus” dont von Hund n’était que le mandataire, elle ne visait rien moins que le rétablissement de l’Ordre défunt et la récupération de ses biens matériels. Des amis de Von Hund prétendirent plus tard qu’il avait été admis dans l’ordre à Paris en 1743 par un mystérieux chevalier “au plumet rouge” dont ils laissaient entendre qu’il était un familier de Charles-Edouard Stuart, fils du prétendant à la couronne d’Angleterre et d’Ecosse [3] (A.Bernheim, 1998). Il aurait reçu une patente de Grand Maître Provincial dont il s’était servi pour introduire l’Ordre en Allemagne. Si les supérieurs inconnus étaient parfaitement imaginaires, cette patente existe bel et bien. Conservée dans les archives de la Grande Loge du Danemark, elle est rédigée en un langage chiffré dont nul jamais ne donna la clef.
Tout cela, faut-il le dire, ne fut connu de Willermoz que bien plus tard, après qu’il eut depuis longtemps mesuré les faiblesses du système allemand.
En 1772 donc, Willermoz sollicita son admission au sein de la Stricte Observance dans une lettre adressée à von Hund en date des 14 et 18 décembre (in Steel-Maret, 1893, pp. 147-153). Celui-ci lui répondit le 18 mars 1773 et le renvoya au baron de Weiler, son émissaire chargé d’implanter l’Ordre en France. La correspondance échangée montre à l’envi le quiproquo : le lyonnais parlait de l’objet caché de la maçonnerie qui ne pouvait traiter que des questions essentielles, l’allemand n’avait en vue que la restauration de l’Ordre du Temple. Nonobstant cette incompréhension fondamentale (ou peut-être à cause d’elle), les négociations n’allèrent pas sans quelques difficultés suscitées par la méfiance des frères lyonnais de la Grande Loge des Maîtres Réguliers que Willermoz eut bien peine à amadouer (A.Joly, 1938, pp.47-50). Tout finit pourtant par s’arranger et Weiler, qui avait déjà établi à Strasbourg le directoire écossais de la V° Province Templière dite de Bourgogne (octobre 1773), put inaugurer celui de la II° Province dite d’Auvergne à Lyon le 21 juillet 1774, puis, la même année, celui de la III° Province dite d’Occitanie à Bordeaux (A.Joly, 1938, p.63).
Armés chevaliers par Weiler les 11 et 13 août, Willermoz et ses disciples avaient prêté serment d’obéissance au baron von Hund et au duc de Brunswick-Lünebourg, “Superior Magnus Ordinis” depuis que le convent de Kohlo (juin 1772) avait reconnu l’inanité des prétentions de von Hund, ce qu’ignoraient d’ailleurs les lyonnais.
En échange, ils avaient reçu leur nom d’Ordre ( Eques ab Eremo pour Willermoz) et les cahiers des rituels allemands. On devine sans peine leur déception. Loin de leur apporter la manne attendue, ces rituels ne différaient guère de ceux que connaissaient les Français. Quant à la “survivance” templière, Willermoz connaissait depuis toujours l’inanité de cette chimère, amoureusement cultivée par d’aucuns depuis que Ramsay, en un célèbre discours, avait attribué aux chevaliers Croisés la paternité de l’Ordre maçonnique. De ceux-ci aux templiers, il n’y avait qu’un pas que les émules du chevalier de Saint-Lazare avaient aisément franchi. Le lyonnais n’ignorait rien de cette fable enseignée dans les grades de “Commandeur du temple” ou de “Chevalier templier” pratiqués dans le chapitre de son frère (A.Joly, 1938, p.15). N’était-ce pas d’ailleurs la justification du Kadosh qu’il avait appris à connaître en 1762 et dont il se méfiait depuis lors? ( cf. la lettre de Meunier de Précourt du 29 avril 1762, in Steel-Maret, 1893, pp. 79-80). Echaudé peut-être mais sérieux comme toujours il le fut, Willermoz se mit au travail, bien décidé à faire de la capitale des Gaules le phare de la maçonnerie templière.
Un an plus tard, le convent de Brunswick (26 mai au 6 juillet 1775) ratifia la “restauration” des provinces françaises et les “Règlements généraux” de l’Ordre furent expédiés à la V° Province. Ils stipulaient que “l’Ordre Intérieur, voilé sous le titre de Directoire écossais, (était) composé de trois grades qui en font partie, et dont le dernier en est le complément. Savoir : 1° celui d’Ecossais Vert qui commence à en développer les symboles, mais par lequel l’Ordre ne s’engage point à l’avancement de celui qui y est admis et peut le laisser pendant toute sa vie…2° celui de Novice…3° le grade de Chevalier…On appelle Profès ceux qui ont fait leur dernière profession ; cette profession n’est point un grade qui augmente les connaissances mais un acte libre et uniquement à la volonté de celui qui le fait, par lequel il s’engage irrévocablement envers l’Ordre” (cité par J.F.Var, 1991, pp.49-50).
Le dernier grade était divisé en six classes selon la condition sociale de l’impétrant (Eques, socius, armiger, clerc, servant et valet d’armes), distinctions mondaines qui n’empêchaient pas que les “connaissances” de l’Ordre soient communiquées à tous (sauf aux servants d’armes).
Pour des raisons dictées, sans doute, par les usages locaux, Weiler avait en 1773 concédé aux strasbourgeois le droit de *****uler les hauts-grades français avec ceux de l’Ordre Intérieur, constituant par là une classe intermédiaire qui fut évoquée par le chapitre d’Auvergne, à Lyon, en sa séance du 23 juillet 1774 : “…On a lu pareillement les deux autres grades du Grand Ecossais Rouge et du Chevalier de l’Aigle, dit Rose-Croix : ils ont été proposés pour la seconde classe intermédiaire à l’instar de la V° Province” (3° protocole de la Province d’Auvergne).
L’échelle des grades adoptée à Strasbourg différait donc de celle en usage en Allemagne par cette “deuxième classe” intermédiaire entre le symbolique et l’intérieur, soit :
1° classe : apprenti, compagnon, maître.
2° classe : écossais rouge, Rose-Croix.
3° classe : écossais vert, novice, chevalier. (A.Joly, 1938, pp.66-67).
Les lyonnais ne se prononcèrent pas sur la mise en application de ce système et renvoyèrent à plus tard “l’examen et la décision des grades qui composeraient la 2° classe”. Dans un premier temps, ils se rallièrent à la position strasbourgeoise, comme l’atteste le “Petit mémoire d’instruction” remis, l’année suivante, au F.
Bruyzet chargé par le chapitre d’Auvergne de répandre dans les loges de France la réforme germanique. Il précisait que les loges désireuses de s’agréger au nouveau système “pourraient obtenir du directoire la permission de conférer (les grades de la classe intermédiaire)…Tout grade d’élu et tout cordon noir étaient proscrits. Les grades de la 2° classe dite intermédiaire étaient l’écossais rouge et le chevalier d’Orient” (in Steel- Maret, 1893, pp. 175-176). Le débat, de toute façon, fit long feu : en 1777, le chapitre de Bourgogne renonça aux grades intermédiaires (R.Dachez et R.Désaguliers, 1989, 80:290).
Restait à résoudre le problème posé par l’implantation en France d’un organisme d’obédience étrangère. Ni Willermoz ni les templiers d’Auvergne ne voulaient rompre avec le Grand Orient de France, garant de la bienveillance du gouvernement. Dès janvier 1776, Willermoz annonçait que des négociations étaient amorcées avec l’obédience parisienne et qu’il en attendait une issue favorable. De fait un “Traité d’Union Intime” fut signé le 31 mai de cette année entre le Grand Orient de France et les trois Directoires de Lyon, Bordeaux et Strasbourg, représentés par Bacon de la Chevalerie, bien connu pour ses accointances Coen (in L. Charrière, 1938). Ce traité, en dix articles augmentés de deux articles “secrets”, prévoyait la réunion des Directoires et de leurs corps subordonnés au Grand Orient (article 1). Chacun “conservait exclusivement l’administration et la discipline sur les loges de leur Rite et Régime” (article 6). L’équivalence des “grades fondamentaux” des deux Rites était garanti, comme les droits d’intervisite et de double appartenance : “Les membres des loges de l’un et l’autre Rites pourraient régulièrement passer dans les loges de l’autre Rite, sans cesser d’être membre de la loge à laquelle ils appartenaient primitivement” ( article 9). Ce Traité, qui devait être reconduit en 1811 sans modifications notables, ratifiait la parfaite régularité de la maçonnerie “réformée” et, jamais dénoncé, justifie, aujourd’hui encore, la pratique du Rite Rectifié au sein du Grand Orient de France.
2. Les grades de la Stricte Observance (1775).
Les rituels conservés à la bibliothèque municipale de Lyon furent récemment publiés par J.F.Var (1991) qui les juge rudimentaires, d’une maigreur squelettique et dépourvus de toute valeur initiatique : “de la gestuelle, un moralisme banal, rien de plus” (p.53). Le jugement est abrupt et sans nuances, reconnaissons-le. Est-il mérité? Chacun jugera, selon ses vues, sans oublier que ces rituels ne diffèrent guère de ceux en usage dans les loges du temps, de ce côté ou de l’autre du Rhin.
La disposition générale de la loge bleue est celle, “ordinaire”, des loges françaises.
Elle est éclairée par trois bougies devant le vénérable, deux devant les surveillants, une devant le secrétaire. Les flambeaux d’angle, autour du tableau (ou tapis), ne sont pas mentionnés. Est-ce à dire qu’ils manquaient? C’est peu probable au vu des usages de l’époque. Gageons plutôt que l'”ordinaire” prévoyait la disposition classique des flambeaux aux angles N.E., S.E. et S.O., conforme aux prescriptions du Rite Français ainsi qu’à celles du Rite Suédois. De fait, une gravure représentant la loge d’apprenti-compagnon selon le Rite de la Stricte Observance, attribuée au dernier tiers du XVIII° siècle, nous les révèle ainsi disposés autour d’un tableau qui ne diffère en rien de ceux présentés par les divulgations continentales des années 1745-1755 (do*****ent conservé dans les archives de la Grande Loge du Danemark, in K.C.F. Feddersen, 1982, d/14) (pl.1).
Relevons une innovation notable, pleine d’avenir : “Derrière la chaire du vénérable est pendu peint sur du carton ou autrement le symbole du grade que l’on y donne”. Ce symbole est “une colonne rompue par en haut mais ferme sur sa base” (1° grade), “une pierre cube (sic) sur laquelle est posée une équerre” (2° grade), “un vaisseau démâté sans voiles et sans rames, tranquille sur une mer calme” (3° grade). Les devises s’y rapportant sont, dans l’ordre, “Adhuc Stat”, “Dirigit Obliqua”, “In Silentio et Spe Fortitudo mea”.
L’ouverture des travaux ne comporte ni allumage des flambeaux ni prière. Le vénérable, après un bref échange de répliques du catéchisme avec les surveillants, ouvre la loge par trois fois trois coups, devant les frères debout tenant de la main gauche l’épée, pointe en terre, et portant la main droite au col. La réception ne s’écarte guère de l’exemple français, si ce n’est par une autre innovation remarquable : la “lumière” est donnée en deux temps avec, au deuxième temps, l’exclamation “Sic Transit Gloria Mundi”. L’obligation d’apprenti comprend les pénalités traditionnelles (gorge coupée, coeur percé et arraché, le tout réduit en cendres). Le catéchisme rappelle les fondements de la loge française et son articulation en trois colonnes (Sagesse-Force-beauté) et trois Grandes Lumières, ici énoncées “le Soleil, la Lune et les Etoiles”, celles-ci remplaçant, on ne sait trop pourquoi, le Maître de la Loge (ou l’Etoile Flamboyante.). Le soleil signifie le maître en chaire, la lune les surveillants et les étoiles les maîtres et compagnons “qui guident les apprentis dans les routes sombres et mystérieuses de l’Art Royal”.
Le deuxième grade, réplique succincte du premier, était sans doute conféré le même jour. Les mots sacrés sont, dans l’ordre, J… et B… comme le voulait l’usage continental depuis l’inversion (anglaise) de 1739 (cf. G.Verval,1988), les mots de passe ceux révélés par le “Trahi…” de 1744,Tub…et Schi…
La réception à la maîtrise suit la version “française” de la légende d’Adonhiram : les neuf maîtres envoyés à sa recherche décident de leur propre autorité de changer le “mot de maître”, mesure dictée par la seule prudence. Sur la tombe de l’architecte est déposée “une médaille triangulaire sur laquelle est gravé l’ancien mot de maître avec deux branches d’acacia en sautoir”. L’instruction précise que cet ancien mot n’est autre que “le Saint Nom de l’Eternel en hébreu”. Après l’obligation, le candidat est renversé et recouvert d’un drap noir tandis qu’on allume les “neuf cierges jaunes”, seule allusion aux flambeaux d’angle ( qu’un autre do*****ent conservé à Copenhague, daté de 1770, montre aux angles habituels, in Feddersen, 1982, d/94, pl.2 ). Le signe d’horreur est le seul enseigné au nouveau maître, le signe “au ventre” relevant d’une autre tradition, celle des “Anciens” anglais. Enfin le mot de passe, Gi…, et le mot “substitué” M…B… sont ceux de la tradition française.
L’écossais vert achève la série. Pour simple qu’il soit, il contient déjà des éléments bien reconnaissables. Le candidat, désarmé, une corde à la taille et sous la menace d’un glaive, est introduit dans la loge tendue de vert et éclairée par quatre lumières disposées en carré. Délivré du joug de “la maçonnerie symbolique” par son engagement d’obéissance au directoire et à ses chefs, il reçoit l'”habit” (le tablier) vert, un signe “la main droite comme pour saisir quelqu’un par la tête”, un attouchement au coude et deux mots, Jehovah et Notuma. S’il n’est fait mention ni de Zorobabel ni du second temple, le tableau montre Hiram ressuscitant “qui tend les bras pour sortir du tombeau où il n’est plus qu’à demi” (pl.3). Il est entouré de quatre animaux, emblèmes des vertus du grade : le lion (valeur et générosité), le singe (adresse et habileté), l’épervier (clairvoyance) et le renard (ruse sans fourberie). A peu de choses près, ces animaux sont ceux que présentait, au grade d'”écossais”, le tableau de la divulgation de 1747, “Les francs-maçons écrasés…” (la colombe y remplaçait l’épervier) (pl.4).
3. Premières réformes.
Après la mort de Weiler (novembre 1775) et celle de Hund (8 novembre 1776), les lyonnais décidèrent d’étoffer les rituels, décidément trop rudimentaires à leurs yeux, de leurs initiateurs germaniques. De décembre 1777 à janvier 1778, il fut décidé de confier à Willermoz et au strasbourgeois Salzmann la rédaction des grades symboliques, à Jean de Türckeim, autre strasbourgeois, celle des grades de l’Ordre Intérieur. Dans la foulée, Willermoz s’attribua la rédaction d’une classe nouvelle, “secrète”, la (Grande) Profession.
Dans la Stricte Observance, la Profession , nous l’avons vu, n’était pas un grade mais l’acte libre par lequel le chevalier s’engageait irrévocablement envers l’Ordre, à l’instar de la “profession” monastique. L’ambition ici était toute autre : il s’agissait de condenser l’enseignement théosophique de Martinez, du moins sa partie théorique, en de longues “Instructions” qui ne seraient communiquées qu’aux élus jugés dignes de les recevoir en deux grades “secrets”, la Profession et la Grande Profession.
Le travail fut rondement mené : les textes étaient déjà près lorsque se réunit le Convent des Gaules, dix mois plus tard. [4] Quelques remaniements apparaissent déjà dans les “trois premiers grades des Loges Rectifiées en France avant la tenue du Convent national de Lyon en 1778” (in Dachez et Désaguliers, 1989, pp.294 et suivantes). Conservées dans les archives de la Cour et de l’Etat à Vienne, ils sont paraphés par Gaybler qui sera secrétaire du Convent de Lyon. On y remarque le soin tout particulier accordé à la préparation du candidat. Un frère “préparateur” est désigné à cet effet et son rôle minutieusement détaillé qui ne rappelle en rien les brimades écossaises des manuscrits d’Edimbourg (1696-1700), pas plus d’ailleurs que les rodomontades du “Frère Terrible” des loges françaises. L’accent est celui de la dignité et du formalisme qui visent à convaincre le candidat de l’importance de sa démarche autant qu’à s’assurer de sa sincérité.
Les cérémonies elles-mêmes sont peu modifiées. Relevons en passant que le mot de passe, ou plutôt le nom, du maître est “acacia” et non Gi…
La bibliothèque nationale de Paris conserve une autre série de rituels “intermédiaires”, venant de Strasbourg ceux-là (“Régime rectifié 1776.
Directoire Ecossais de Strasbourg avant le Convent Général tenu à Wilhelmsbad en 1782″, cité par Dachez et Désaguliers, 1989, pp.297 et suivantes). Malgré leur date (1776), ils ne diffèrent que peu de ceux qui seront adoptés à Lyon deux années plus tard.
Les maximes lors des voyages manquent encore mais les châtiments physiques traditionnels sont déjà omis des serments.
Le 27 avril 1777, le Directoire d’Auvergne arrêta que le grade d’écossais vert serait rendu “ostensible” dans toutes les loges sous la seule dénomination d'”écossais”, devenant ainsi le “complément de la maçonnerie symbolique” et non plus le premier de l’Ordre intérieur. Cette délibération “définitive” prévoyait aussi que les vénérables communiqueraient “sans cérémonies et sans frais” aux écossais les hauts-grades en usage avant la réforme : chevalier d’Orient, Rose-Croix et autres de la même veine (article 7), à l’exclusion toute fois des grades “à cordon noir”, élus ou kadosh que Willermoz avait en horreur. Ces grades étaient expressément proscrits et il était interdit aux visiteurs d’autres régimes d’en porter les décors en loge (article 9). Cette décision supprimait de fait la classe “intermédiaire”, concédée autrefois par Weiler, dont les lyonnais ne savaient trop que faire [5].
L’article 6 de cette même délibération décrit le tableau du grade d’écossais et son “symbole distinctif” : un lion jouant avec des instruments de mathématiques, ainsi que sa devise “Maeliora praesumat” (sic) (in Renaissance Traditionnelle, 1989, pp.313-316 et Cahiers verts, Bulletin Intérieur du Grand Prieuré des Gaules, 1992, n° 10-12, pp.233-237). Cet écossais, nouvelle manière, synthèse de l’écossais vert importé d’Allemagne et des grades écossais pratiqués en France, sera développé au Convent de 1778.
Nota: